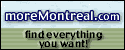|
PUBLICATION SCIENTIFIQUE
L'IMPACT DE
L'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE OFFSHORE SUR LA HAUSSE DU NIVEAU MOYEN
RELATIF DE LA MER . Par A. El Fouladi
Référence bibliographique:
El Fouladi, A. Hausse du niveau
moyen relatif de la mer à Trinidad (Caraïbes) : Évidence, causes
probables et évaluation. Ph.D., Département de géographie, Université
de Montréal Mai 2006. 192 pages + Annexes.
(Thèse de doctorat ayant montré que la
disparition de certaines zones côtières de l'île de Trinidad seraient
dues à l'exploitation excessive du pétrole et du gaz naturel offshore
et non au seul réchauffement climatique)
Résumé
Depuis 1990, les signes avant-coureurs d’une hausse généralisée du
niveau moyen de la mer se multiplient à Trinidad, laissant supposer
que cette île serait déjà en train de subir les impacts du
réchauffement global de la planète.
Afin de cerner ce qui est en train de se passer dans cette île des
Caraïbes, on a recensé, à travers une revue de littérature, les
différentes causes qui pourraient contribuer à la hausse du niveau
moyen relatif de la mer (HNMRM) d’où on a extrait celles qui
concernent notre zone d’étude. Les causes retenues ont été classées en
deux catégories: La dynamique océanique et la dynamique continentale.
La dynamique océanique est constituée de la dilatation thermique des
océans et de la fonte des glaces sous l’effet du réchauffement global
de la planète. Ces deux derniers facteurs contribuent à la hausse
(absolue) du niveau moyen de la mer appelée dans cette étude « hausse
du niveau moyen de la mer » ou HNMM.
Quant à la dynamique continentale, elle contient les facteurs qui,
agissant seuls ou conjointement avec la HNMM, confèrent à la hausse de
la mer un caractère relatif. On parle alors de hausse du niveau moyen
relatif de la mer (HNMRM). De ces innombrables facteurs on a retenu le
rebond postglaciaire (RPG), obtenu par interpolation des résultats
d’un modèle de simulation approprié, et l’isostasie sédimentaire dont
la valeur a été puisée dans la littérature.
Tout en soulignant qu’il est possible d’assurer un suivi de
l’évolution de ces deux dynamiques par marégraphie ou par altimétrie
satellitaire, on a mis à contribution des mesures marégraphiques in
situ ainsi que des simulations de deux modèles de circulation générale
couplés « atmosphère océan » (MCGAO) pour les évaluer et pour montrer
que la dynamique continentale n’est pas nulle, dans le cas de
Trinidad, et l’emporte même sur celle océanique. Les résultats des
calculs situent la dynamique océanique entre 0,5 et 5, 3 mm/an et
celle continentale entre 5,7 et 18,6 mm/an.
Les analyses des profils de plages, de l’intrusion des sels marins
dans les aquifères, de l’exploitation pétrolière et de la
recrudescence des séismes ont été utilisées pour confirmer la
dominance de la dynamique continentale et pour montrer, qu’au sein de
celle-ci, la subsidence due au compactage des couches sédimentaires
suite à l’exploitation intensive du pétrole dans la région, semble
expliquer le mieux la HNMRM observée dans quelques zones de l’île
depuis 1990.
L’étude a également ciblé deux sites sensibles de l’île où un système
d’information géographique (SIG) a été utilisé pour évaluer
l’intrusion de la mer et son impact sur des projets économiques en
cours ainsi que sur l’occupation des sols.
Des simulations ont été faites pour trois époques différentes (2031,
2051 et 2071) avec des scénarios de la contribution océanique (estimée
à partir des outputs du MCGAO britannique, le HadCM3, et de celui
canadien, le MCCG2) et des scénarios de la contribution continentale
assimilée au résultat des quelques études ayant évalué l’érosion et le
recul annuel des côtes.
Les output du SIG consistent en des tableaux statistiques évaluant les
pertes en superficie des différents éléments de l’occupation des sols
(espaces bâtis, couvert végétal et forestier, terrains agricoles…).
Ils contiennent également des cartes thématiques montrant l’évolution
temporelle de l’intrusion de la mer dans les sites étudiés ainsi que
l’impact de cette intrusion sur les éléments de l’occupation des sols
et des projets économiques. La méthodologie ayant été développé, pour
obtenir ces outputs, pourrait être utilisée pour mener des études de
prévention et de mitigation face à la HNMRM.
Mots clés : Subsidence, Hausse relative du niveau de la mer,
changement climatique, petites îles, réchauffement global, érosion
côtière, SIG, récession côtière, dilatation thermique.

|